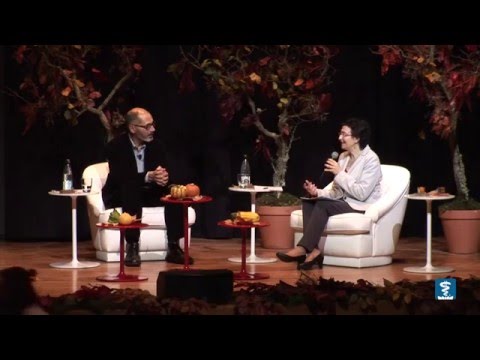Christophe André et la psychologie positive
Médecin psychiatre à l’hôpital Sainte-Anne à Paris, Christophe André est l’une des figures majeures de la diffusion de la psychologie positive en France. Cette approche scientifique, née dans les années 2000 sous l’impulsion de Martin Seligman, s’intéresse non pas seulement à ce qui ne va pas – comme la dépression ou l’anxiété – mais aussi à ce qui favorise le bonheur, la résilience et l’épanouissement.
Dans ses ouvrages et ses conférences, André encourage chacun à « ruminer le positif », c’est-à-dire à prendre le temps de savourer et de revisiter des moments agréables pour contrebalancer notre tendance naturelle à retenir surtout les expériences négatives. Cette démarche rejoint directement la pratique sophrologique, qui invite à revivre consciemment un souvenir agréable ou à anticiper un futur positif afin d’ancrer ces ressentis dans le corps et l’esprit.
Des principes déjà éprouvés
Sophrologie : une pratique rationnelle au cœur des dynamiques corps-esprit
La sophrologie est parfois regardée avec méfiance, accusée de ne reposer que sur un effet placebo. Pourtant, cette vision réductrice ne tient plus face aux avancées scientifiques en neurosciences et en psychologie. Bien au contraire, le rapprochement avec des phénomènes tels que l’effet placebo, les mécanismes psychosomatiques, ou les similitudes avec la psychologie positive et l’implémentation d’intention permet de comprendre la profondeur et la légitimité de cette discipline.
Les argumentations de Christophe André dans ce chapitre sont tirés du séminaire MÉDITATION DE PLEINE CONSCIENCE & SOPHROLOGIE dont la vidéo est disponible à la suite de ce chapitre.
L’effet placebo : un mécanisme scientifique reconnu
Longtemps déconsidéré comme une simple autosuggestion, l’effet placebo est aujourd’hui reconnu comme un processus neurobiologique mesurable. La confiance dans un traitement ou dans une méthode déclenche la libération de neurotransmetteurs comme les endorphines, la dopamine ou la sérotonine, modulant ainsi la douleur, l’anxiété ou le bien-être.
Comme le souligne Christophe André : « Ce qu’on appelait l’effet placebo et qu’on traitait avec beaucoup de mépris en médecine, c’est tout simplement la capacité de notre esprit à se guérir lui-même, à sécréter des endorphines et à soulager ses souffrances. »
La sophrologie ne se réduit pas à cet effet, mais elle s’appuie sur des mécanismes similaires en les mobilisant de manière consciente et intentionnelle. Là où le placebo agit souvent à l’insu de la personne, la sophrologie propose une pratique structurée permettant à chacun d’activer volontairement ces ressources intérieures et d'en augmenter la portée.
Psychosomatique et interaction corps-esprit
Les phénomènes psychosomatiques confirment également l’influence réciproque de l’esprit et du corps. Le stress chronique, par exemple, modifie l’équilibre hormonal et affaiblit le système immunitaire, tandis que des états de détente favorisent la régulation physiologique.
C’est précisément dans ce champ que s’inscrit la sophrologie, par ses exercices de respiration, de relaxation dynamique et de visualisation. Elle vise à restaurer un équilibre global, harmonisant psychisme et physiologie.
Une approche cousine de pratiques reconnues
Christophe André rappelle que nous vivons une période charnière : « Nous sommes en train de redécouvrir le pouvoir guérisseur de l’esprit… Nous entrons dans une décennie où nous allons explorer toutes ces disciplines cousines – sophrologie, hypnose, méditation – pour mieux comprendre leurs similitudes et leurs différences. »
Ces recherches montrent que, si l’hypnose active dans le cerveau des mécanismes proches du placebo, la méditation suit d’autres voies. La sophrologie, elle aussi, possède sa dynamique propre, tout en partageant avec ces disciplines l’objectif d’une meilleure écologie de l’esprit.
Toujours selon Christophe André, ces approches « comme le Vittoz ou la sophrologie sont des approches qui très clairement marchent. Sur le terrain on voit très bien des patients qui sont améliorés par ces approches la question n'est pas là.» Le défi réside dans la production d’études contrôlées qui permettront d’intégrer pleinement ces pratiques dans le champ médical.
Sophrologie et psychologie positive : un principe commun
La sophrologie partage avec la psychologie positive une approche fondée sur l’activation d’expériences agréables.
En psychologie positive, des exercices comme la gratitude, la remémoration de moments heureux ou la projection dans un futur souhaité visent à rééquilibrer la balance émotionnelle et à renforcer la résilience.
La sophrologie mobilise des principes sous-jacents comparables ou identiques grâce à la visualisation positive : revivre un souvenir plaisant, se projeter dans une réussite future, ou encore installer une sensation de sécurité et de confiance. Ces pratiques ne sont pas de simples « images mentales » : elles génèrent de véritables réponses physiologiques (détente musculaire, respiration apaisée) et émotionnelles (joie, apaisement, confiance).
La différence se situe surtout dans l’approche : la psychologie positive s’appuie sur la recherche académique et des protocoles validés scientifiquement, tandis que la sophrologie associe le mental et le corps par des techniques psychocorporelles structurées.
Ces deux démarches sont donc complémentaires : elles valorisent les ressources positives de l’individu et favorisent l’épanouissement personnel en s’appuyant sur des leviers similaires.
L’apport de la sophrologie va au-delà de la pleine conscience par son travail spécifique sur le passé et l’avenir. Comme l’explique Natalia Caycedo, il s’agit d’apprendre à anticiper de manière positive et intentionnelle, plutôt que de subir les ruminations ou les regrets.
Christophe André reconnaît d’ailleurs : « ... avant de rencontrer Natalia j'avais pas compris qu'il y avait toute cette dimension des valeurs et de la psychologie positive dans la sophrologie. C'est plus complexe que la méditation parce qu'il y a des éléments très clairement voisins de ce qu'on fait en psychologie positive."
Sophrologie et implémentation d’intention : un principe commun
L’implémentation d’intention est une stratégie d’autorégulation psychologique rigoureusement étudiée et validée par la recherche, introduite par Peter Gollwitzer. Elle repose sur la définition d’un plan d’action précis associant un contexte clair (moment, lieu, situation) à une réponse comportementale ciblée, facilitant ainsi la transition d’une décision consciente vers une action automatique et efficace. En sophrologie, cette démarche trouve une résonance directe notamment à travers l’usage de la visualisation et du geste-signe qui créent un ancrage mental puissant. Par la répétition et la projection sensorielle d’un état intérieur positif dans une condition spécifique, la sophrologie prépare le terrain pour que l’intention se traduise par une réaction spontanée et intégrée, réduisant la dépendance à la seule volonté consciente. Cette convergence illustre que les effets bénéfiques de la sophrologie reposent sur des mécanismes psychologiques actifs et bien documentés, posant ainsi la sophrologie non seulement comme une pratique d’accompagnement corporelle et mentale, mais aussi comme une méthode efficiente alignée sur des principes d’autorégulation reconnus en psychologie cognitive contemporaine.
Conclusion
Loin d’être une pratique marginale ou irrationnelle, la sophrologie s’appuie sur des processus neurobiologiques et psychologiques objectivés par la recherche. Si la sophrologie n’est pas encore pleinement validée par la recherche, elle repose néanmoins sur des thèses rationnelles solides : elle harmonise le corps et l’esprit à travers des techniques déjà reconnues individuellement pour leurs effets. L’effet placebo et les phénomènes psychosomatiques démontrent scientifiquement que l’esprit peut influencer le corps, et inversement. La cohérence rationnelle de la sophrologie tient justement à cette intégration des savoirs psychocorporels et à son ancrage dans une vision holistique de l’humain, compatible avec la physiologie et la psychologie contemporaines.
La « grande étude scientifique » 2022-2025 menée auprès des aidants de personnes atteintes d’Alzheimer, portée par l’A-MCA et la Chambre syndicale de la Sophrologie (citée précédemment) devrait bientôt apporter une nouvelle perspective de collaboration ou de reconnaissance scientifique.
En somme, la sophrologie est une discipline en évolution, fondée sur des mécanismes compréhensibles et cohérents avec la science actuelle, ouverte aux progrès futurs et à l’évaluation scientifique. Elle apparaît ainsi comme une méthode rationnelle et complémentaire, inscrite dans une famille de pratiques validées par l’expérience clinique, et destinée à renforcer l’équilibre, la résilience et le mieux-être.
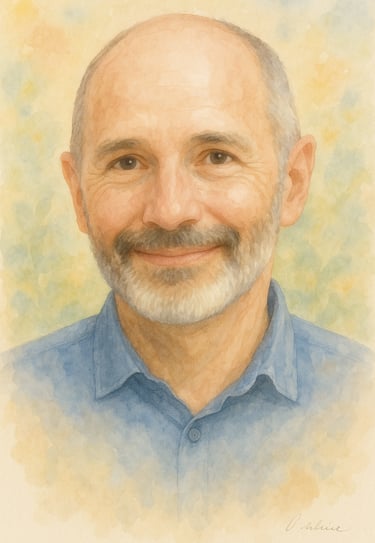
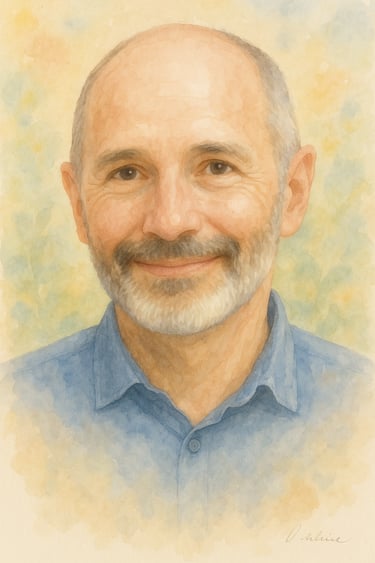
La psychologie positive
(Source Wikipédia)
La psychologie positive est une discipline de la psychologie fondée officiellement en 1998 lors du congrès annuel de l'Association américaine de psychologie par son président de l'époque, Martin E. P. Seligman (cf. son discours publié en 1999 dans le journal de l'APA, The American Psychologist). Cependant, la psychologie positive a des racines plus anciennes. La psychologie positive ne doit pas être confondue avec la pensée positive, une pseudo-science basée sur l'autosuggestion, faisant l'objet de nombreux best-sellers vendus à des millions d'exemplaires à travers le monde depuis les années 1950.
La psychologie positive s’intéresse surtout à la santé, à qualité de vie et au bien-être, à ce qui rend les humains résilients, heureux, optimistes, plutôt qu'aux sources des psychopathologies. L'hypothèse de la psychologie positive est qu'en étudiant pourquoi et comment certains animaux et certaines personnes surmontent mieux que d'autres les difficultés de la vie, il sera possible de trouver des moyens de développer ces qualités chez tout un chacun. Son objectif est de promouvoir l’épanouissement (en anglais, flourishing) et l’accomplissement de soi (en anglais, fulfillment), au niveau individuel, groupal et social. La psychologie positive « étudie ce qui donne un sens à la vie », selon son fondateur, Martin E. P. Seligman. C'est l’étude des forces, du fonctionnement optimal et des déterminants du bien-être.
Ce domaine de la psychologie s'inscrit ainsi dans la tradition de la psychologie expérimentale dont elle utilise les méthodes, basées sur la validation d'hypothèses, et elle se rapproche dans ses concepts de la psychologie humaniste (dont elle diffère surtout par ses méthodes). Ses concepts et méthodes peuvent aussi emprunter à d'autres disciplines de la psychologie, des neurosciences et des sciences humaines.
Transcription
Christophe André: «Je serais frustré si on parle pas quand même un peu de de la suite des événements. Moi ma conviction, vous parliez au tout début des histoires de discipline cousine.
Je crois qu'il y a quelque chose de très fort qui est en train de se joué actuellement dans le champ, pas seulement de la médecine, mais du soin en général.
On est en train d'arriver à une certaine limite de la médecine traditionnelle avec les médicaments, la démarche, je soigne un symptôme par un médicament, et cetera... Et de redécouvrir la puissance de qu'on pourra appeler, «la médecine du cerveau» ou le pouvoir guérisseur de l'esprit. Voilà si ça vous intéresse d'ailleurs il y a une revue qui est très intéressante qui s'appelle cerveau et psycho qui vient de publier un hors série sur je sais pas « l'esprit qui guérit», je sais plus comment ça s'appelle, dans laquelle on a réuni pas mal d'articles. On est en train de redécouvrir l'eau tiède : Les médecins, les chercheurs, les scientifiques sont en train de s'apercevoir que finalement, par exemple, ce qu'on appelle l'effet placebo qu'on traitait avec beaucoup de mépris en médecine en disant «c'est de l'autosuggestion» et cetera c'est tout simplement la capacité de notre esprit à se guérir lui-même, à guérir ses souffrances lui-même, à sécréter des endorphines et cetera et cetera. Hier je faisais un cours avec plusieurs collègues ;
On a créé un diplôme universitaire de de méditation et relation de soins, et on faisait le cours sur les neurosciences la recherche en neurosciences et cetera, donc on avait invité quelques jeunes chercheurs qui travaillent sur l'hypnose qui travaille sur l'imagerie cérébrale et cetera... Et l'un d'entre eux présentait des résultats très passionnants : Il comparait ce qui se passe dans le cerveau des personnes qui ont des douleurs chronique selon qu'on les aide par hypnose ou par par la méditation. Dans les deux cas ça marche très bien tout comme la sophrologie marche certainement très bien. Ce que montrait ces recherches c'est que ça ne passe pas par les mêmes voies cérébrales. Ce que montre en gros ces recherches c'est que l'hypnose passe par les même voie que le placebo. Vous savez que quand vous donnez un placebo à un volontaire et que vous regardez dans son cerveau ce qui se passe au au niveau de la neuro-imagerie il y a des modifications assez fortes qui correspondent aux zones du cerveau qui libèrent des endorphines parce que quand le placebo marche c'est pas juste de la suggestion. C'est que le cerveau se met à libérer des endorphines parce que la personne croit que le médicament va la soigner. Mais on peut continuer à progresser dans la connaissance de nos fonctionnement cérébraux pour que le cerveau puisse libérer des endorphines sans qu'il croit recevoir ou non un médicament et c'est très certainement ce à quoi arrivent certains yogi, certains Lama, certains de nos patients.
Donc d'un côté on s'aperçoit que finalement l'hypnose provoque dans le cerveau exactement les mêmes modifications mesurables objectivable que l'administration de placebo là où la méditation qui agit aussi d'un point de vue clinique qui soulage ne passe pas du tout par les mêmes voies. Je pense que on est à à l'aube d'une décennie très probablement où on va explorer toutes ces disciplines cousines, où on va essayer de se dire bon les gens qui font de la sophrologie comment ça se passe dans le cerveau ? ... ceux qui font de l'hypnose ça passe par où ? ...la méditation ça passe par où ? ...la méthode Vittoz ça passe par où et on va mieux comprendre en quoi il y a des approches communes, mais en quoi c'est différent. C'est différent aussi c'est pas pareil de faire de la sophrologie et de faire de la pleine conscience même si dans les deux cas on est dans une approche d'écologie de l'esprit. On essaie de restaurer un certain type de rapport respectueux à son esprit de développer des approches de meilleures connaissances notamment, de ces sensations corporelles, des liens qu'elles peuvent avoir avec notre esprit et cetera. Et donc tout ça est est vraiment passionnant et moi je trouve que c'est important, tous ces projets que vous avez de validation scientifique parce que actuellement c'est la la limitation pour des approches comme le Vittoz ou la sophrologie qui sont des approches qui très clairement marchent. Sur le terrain on voit très bien des patients qui sont améliorés par ces approches la question n'est pas là. La question est que quand on n'a pas les fameuses études contrôlées et bien il y a un barrage qui se fait par rapport à « oui mais est-ce que c'est pas suggestion ceci ou cela» et pour information
l'école Vittoz comme vous a compris ça. Et ils sont en train de mener une très intéressante étude où il compare les effets du Vittoz et les effets de la pleine conscience : Donc il y a une équipe qui est à Grenoble qui a construit un protocole on l'a aidé dans la construction de ce protocole. Et c'est ça l'avenir : Plus il y aura d'outils dans cette famille des soins tels que les nôtres, mieux ça sera pour les patients évidemment.»
Natalia Caycedo : «Tout à fait d'accord en fait, dans ces congrès nous allons déjà présenter des résultats que nous avons eu ici à Barcelone et aidé par la chair de psychiatrie de l'Université Autonome de Barcelone dans lequel, quand on était avec les statisticiens de l'université qui regardaient : «mais comment c'est pour possible des résultats si excellents. C'est-à-dire la chose qui nous a manqué c'est faire des biopsies et parce que la vivance on l'a déjà et ça c'est déjà beaucoup mieux que n'importe quelle table statistique, mais ça viendra.
Je crois que pour nous c'était pas l'objectif essentiel, mais maintenant bien sûr je crois que dès que nous allons commencer à faire ces recherches petit à petit la sophrologie va se connaître dans l'ambiance médicale cartésienne en fait dans 2 semaines et je vais parlé dans un une journée des médecines non complémentaire et qui organise la faculté de médecine de Nice. Je crois que de plus en plus nous sommes en train de voir combien c'est nécessaire ces sortes de, entre guillemets, «médecines complémentaire» parce que nous les médecins même cartésiens, parce que nous avons une éducation comme ça, acceptons et regardons comment nos patients s’améliorent grâce à cette technique. Avant de passer aux questions du public et après de faire la pratique, parce qu'il nous reste encore un petit peu de marche. Le passé, le présent et le futur et la temporalité et la vivance. Je suis tout à fait d'accord que ... en espagnol il y a un poète qui dit «Con recuerdo de esperanzas y esperansas de recuerdos vamos matando el momento presente» - Avec des souvenirs d'espoir et d'espoir de souvenir on tue le moment présent.» Et je suis tout à fait d'accord que dans les moments actuel où dans l'activisme et cetera qui nous entour, on est dans la vie quotidienne, on se trouve ou avec des préoccupations dans le futur ou des regrets ou des mal-être sur le passés. En sophrologie on le travaille dans la technique et je voudrais qu'on le fasse ensemble maintenant que nous allons faire une practique sophologique, parce que nous voyons et le futur et le passé - encore une fois - d'une façon intentionnelle. C'est-à-dire, au lieu de laisser que mes préoccupations prennent la place sur mon esprit ou que mes souvenirs prennent la place sur mes émotions, qu’ainsi ça soit moi qui suis «objet de» je vais être «sujet de» mais de façon tranquille... c'est-à-dire : «Comment voudrais-je être dans le futur, dans mon futur ? » «Comment voudrais-je être ? ... mais d'une façon positive et proactive intentionnel». «Comment voudrais-je être ?» ... là nous travaillons les différents aspects de notre être physique et mental émotionnel et mes valeurs de cette façon que petit à petit - c'est vrai que ce n'est pas une vivance corporelle - mais nous sommes en train d'anticiper ce que nous voudrions petit à petit préparer pour «être», d'une façon je dirais, méthodologique et progressif. De cette façon que cette technique nous aide à nous préparer pour vivre ce moment qui va venir quand il vient parce que normalement on cherche pas à être dans les Bahamas en train de prendre le soleil avec la Pigna Collada mais nous sommes en train de nous imaginer dans notre maison dans un repas familial. Mais donc quand il vient on est encore plus conscient. Comment vous voyez du point de vue de la pleine conscience cette technique par rapport aux prises de conscience du futur qui est là aussi est important. Il faut pas négliger le présent - mais c'est vrai que c'est important aussi le passé et le futur prise d'une façon positive.»
Christophe André : oui oui oui oui oui ça c'est très important mais c'est en ce sens je pense que la sophrologie est plus complexe que la pleine conscience en pleine conscience nos objectifs sont un niveau en dessous : Ce qu'on dit à nos patients, c'est qu'au fond anticipé et ruminer ils le font très bien sans nous et que nous on veut juste rééquilibrer. On veut juste leur apprendre à créer davantage de moments dans leur vie où ils sont simplement présents à ce qu'ils vivent. Effectivement ce que vous dites est juste. Quand vous leur dites «vous savez très bien anticiper» et ruminer c'est à moitié vrai, parce que ils anticipent souvent de manière dysfonctionnelle, ils n'anticipent pas de manière réaliste mais souvent manière dramatisée et pareil pour le fait de se retourner vers leur passé ; ça c'est un travail qu'on développe davantage par contre en psychologie positive, donc c'est clair qu’avant de rencontrer Natalia j'avais pas compris qu'il y avait toute cette dimension des valeurs et de la psychologie positive dans la sophrologie. C'est plus complexe que la méditation parce qu'il y a des éléments très clairement voisins de ce qu'on fait en psychologie positive. En psychologie positive on va apprendre effectivement ( c'est un peu dérivé aussi des approches cognitives) à nos patients à envisager que parmi toutes les hypothèses concernant leur avenir, leur anticipation, les premières qui leur viennent à l'esprit sont les négatives, mais leur dire «mais est-ce que il se peut que vous ne ratiez pas l'avion ... et dans ce cas-là dans quel état vous seriez physiquement ? ... qu'est-ce que ça vous ferait ? » Mais là on est plus soit dans la thérapie cognitive soit dans la psychologie positive. En méditation de pleine conscience (souvenez-vous c'est très influencé par le bouddhisme) et le truc qu'on ne dit pas mais qui est présent) c'est tu lâches toute forme d'espoir et de désespoir tu n'attends rien tu ne regrettes rien tu t'en remets à la vie et tu l'affrontes du mieux que tu peux. La vraie vie, le réel. Le virtuel te piégera que ce soit du côté de l'espoir ou du désespoir revient dans le réel donc on est dans un truc plus épuré plus simple. Voilà en ce sens-là c'est c'est différent.»
MÉDITATION DE PLEINE CONSCIENCE & SOPHROLOGIE par les Drs Christophe André et Natalia Caycedo (Fille du créateur de la sophrologie)